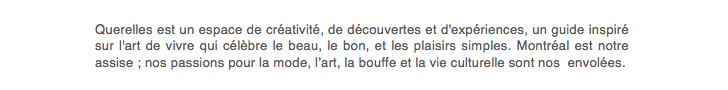Opéra – Hänsel & Gretel : une histoire de faim

La pratique de l’art: Hänsel und Gretel à l’Opéra de Montréal
C’est une histoire de faim.
Beurre, farine, crème, œufs, café, bonbons, tartes, amandes, abricots, prunes et poires, gâteaux, lait au riz, etc. : les références au comestible ne manquent pas dans Hänsel und Gretel, conte des frères Grimm adapté en opéra par Humperdinck et présenté jusqu’au 29 mars à l’Opéra de Montréal. La faim est à la fois le moteur et le nœud de ce conte cannibale, et ne sera résolue à la toute fin que par l’intelligence d’Hänsel et de sa sœur, lorsque ceux-ci prouvent être plus malins que la sorcière en la prenant à son propre jeu. C’est donc une fable classique sur la dualité corps-esprit qui nous est présentée dans cet opéra mis en scène par Hugo Bélanger, où les besoins et conforts du corps sont constamment sublimés par la danse, le chant, le jeu. Mention spéciale à cet égard aux chanteuses Emma Char (Hänsel) et surtout Frédérique Drolet (Gretel), qui ne se contentent pas de chanter (et avec quelle voix !) mais également d’incarner leur personnage avec une gestuelle sentie et précise. Mais si Char et Drolet se présentent comme les « artistes de la faim » de cet opus, les « champions du corps » demeurent sans contredit les artistes de l’École nationale de cirque de Montréal. Ces élèves doués et cabotins –on sent chez eux un réel plaisir du jeu et du deuxième degré- illuminent la scène à chacune de leur apparition : en « anges » ou lutins à pyjama, ils créent une atmosphère cristalline et féérique ; en démons gras et grotesques chez la sorcière, ils parviennent à vicier l’air de la scène et à lui donner la dimension inquiétante qui lui manquait jusqu’alors. À la fois originaux et justes, ils sont le parfait contraste de corps muets avec les incarnations bien sonores des chanteurs de l’opéra.
Une fresque
Finalement, ce qu’ils ajoutent à ce spectacle, c’est du relief. Du non-dit et de l’ombre là où tout n’est que chant et lumière. L’opéra est comme le récit épique que décrit Auerbach : une représentation entièrement externalisée du diégétique, une illustration uniforme et linéaire, sans zones d’ombre, sans ruptures, sans ambiguïtés. C’est une fresque. Tout est là, les peines, les joies, les éléments les plus triviaux, les événements les plus dramatiques. C’est agréable et c’est aussi peut-être l’élément le plus défamiliarisant de l’opéra pour le public post postmoderne (merci théorie critique) que nous sommes : habitués à des narratifs polysémiques, intertextuels, fragmentés, souvent riches de leur perspective historique ou psychologique, l’opéra nous semble excessivement bon-enfant, jovial, simple, « fermé » au sens où son univers ne laisse aucune problématique en suspens, ne génère pas de questions. Ou presque. Une interrogation me taraudait en effet dès les premières notes du spectacle : l’opéra est certes grandiose, dramatique, beau, mais est-il émouvant ? Allais-je réussir à me laisser toucher par ses personnages unidimensionnels, ses décors fantasques, cette histoire de conte de fées ?
L’opéra comme rituel
« La culture est un lieu du secret, de la séduction, de l’initiation, d’un échange symbolique restreint et hautement ritualisé »[1] écrit le philosophe français Baudrillard en 1981. Ainsi en est-il de l’opéra. Dès l’entrée en salle, il est clair que c’est le rituel qui prime ici sur le sort : les musiciens, les acrobates, les acteurs, les choristes, les chanteurs, l’équipe technique, tout ce beau monde déploient une énergie considérable, soir après soir, pour raconter l’étrange histoire de ces enfants allemands. Chacun arrive avec ses ces codes, ses rites ; on sent, assis dans la salle Wilfrid-Pelletier à quelques pas de la fosse d’où s’échinent les musiciens et de la scène où jouent les artistes, que nous sommes dans cet espace de la « séduction … hautement ritualisé » dont parle Baudrillard. Et c’est touchant.
Émouvant alors, l’opéra ? Absolument. Pas à cause des chants de Humperdinck, ni des rebondissements du conte, mais grâce au plaisir évident des artistes de ce spectacle, qui s’adonnent à ce qu’ils font de mieux : la pratique de leur art.
Tout conte qui se respecte transmet une leçon, et voici celle d’Hänsel und Gretel : ce n’est pas le gâteau ou les sucreries au bout de la faim qui comptent, mais la faim elle-même. L’appétit, l’envie, le désir, autant de chemins qui mènent à l’art. Et dans cet opéra, nous sommes servis.
Article: Gabrielle Banabdallah
Photos: Boris Perraud