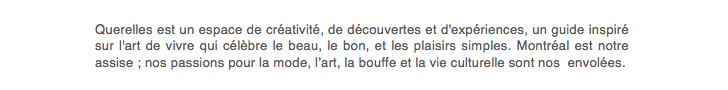Culture – FTA : Henderson/Castle, à la recherche d’un nouvel espace-temps

 C’est un de ces jours de semaine intense, à la fois riche et épuisant. Je franchis les portes de l’Agora de la danse juste quelques minutes avant l’heure, essoufflée, avec un mal de tête lancinant qui me suis depuis le petit matin. Mon niveau de réceptivité est quasi nul. Je me faufile discrètement au premier rang et m’assois, enfin. Le flottement qui précède chaque début de représentation me donne le temps d’apprivoiser l’environnement : une immense salle recouverte de plancher ciré, éclairée par une douce lumière de fin de journée estivale qui filtre à travers les grandes fenêtres, quelques chaises simples éparpillées, un piano discret, et des projecteurs au sol.
C’est un de ces jours de semaine intense, à la fois riche et épuisant. Je franchis les portes de l’Agora de la danse juste quelques minutes avant l’heure, essoufflée, avec un mal de tête lancinant qui me suis depuis le petit matin. Mon niveau de réceptivité est quasi nul. Je me faufile discrètement au premier rang et m’assois, enfin. Le flottement qui précède chaque début de représentation me donne le temps d’apprivoiser l’environnement : une immense salle recouverte de plancher ciré, éclairée par une douce lumière de fin de journée estivale qui filtre à travers les grandes fenêtres, quelques chaises simples éparpillées, un piano discret, et des projecteurs au sol.
Neuf danseurs scintillants prennent alors place dans ce décor dépouillé et enclenchent une série de mouvements. Leur gestuelle est fluide : chacun suit sa propre mouvance, tout en retenue, sur un rythme régulier et uniforme. Effet étrange. Dès l’instant où le mouvement est amorcé, je me sens comme emportée par une force continue. Les danseurs gravitent dans cet espace en jouant avec ses limitations : le mur, l’escalier, les spots, les chaises, le sol, et même nous, spectateurs, sont autant de frontières avec lesquels ils composent, par ricoché, appui, et contournement. Les corps s’étirent, se grattent le nez à la volée, tournent sur eux-mêmes, remontent une boucle de sandale. Jeté, sourire en coin, première position avec les pieds en écart, secousse des épaules, rire étouffé… Je suis hypnotisée, incapable de prédire le mouvement qui va suivre.
Je découvre après coup que la création de Ame Henderson est inspirée du programme Voyager de 1977, qui a envoyé deux vaisseaux spatiaux en mission d’exploration aléatoire. Le défi des danseurs est de créer un mouvement perpétuel et inédit, sans réitération gestuelle durant une heure. Henderson en fait des astres, qui parfois se croisent, comme des vies individuelles et différentes, néanmoins toutes reliés entre elles par un espace collectif et une humanité éternelle à la rythmique sempiternelle.
En guise d’accompagnement musical, Jennifer Castle chante une longue chanson ininterrompue, association de mots et d’idées souvent drôle et enfantine, sans fin et sans repos. Je commence à planer littéralement, jusqu’à ressentir un début de bien-être physique, similaire à cet engourdissement heureux éprouvé juste avant l’endormissement.
Pourtant, mon décrochage ne prend pas. Les notes dissonantes du piano, le bruit agressif de l’harmonica et du froissement de sacs en plastique, me ramènent à la réalité et entravent ma lévitation, générant presque un agacement. Cette cacophonie m’empêche un laisser-aller complet au mouvement perpétuel des danseurs et à la poésie des mots. La différence est trop grande entre ce que je vois et ce que j’entends. Mes yeux se délectent de la performance exceptionnelle offerte par les danseurs du Toronto Dance Théâtre et de leur effort incroyable d’improvisation et de concentration. Mes oreilles, elles, perçoivent une agrégation de sons, sans aucun travail de recherche et de profondeur.
Lorsque la pièce se termine, je ressens une certaine frustration, comme s’il m’avait été donné d’entrapercevoir la lune sans pouvoir l’atteindre. Henderson m’a élevée, Castle m’a enracinée. À elles deux, elles ont créé un espace temps qui a finalement réussi à casser ma rythmique intime, me ballotant du ciel au sol, me faisant apprécier tour à tour la force élévatrice de l’apesanteur et la gravité terrestre, et me rappelant à quel point je suis soumise, comme nous tous, à cette insoutenable légèreté de l’être.
Article : Sonia Reboul